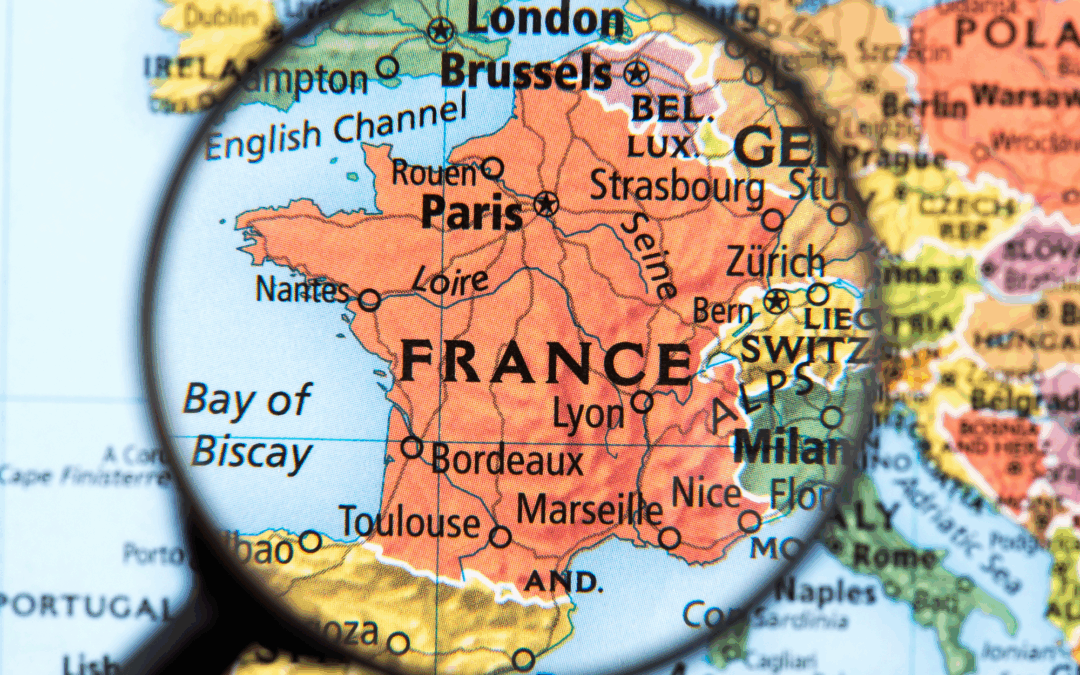Quelle France voulons-nous?
Quels apports de l’Économie de communion pour une France de justice et de paix ?
DOCUMENT DE DEBATS
La réponse à la question posée dans le titre, ne relève pas d’un programme politique. La seule ambition est de proposer un cadre de réflexion et de cohérence des enjeux et des réponses à y apporter, dans une vision systémique fondée sur l’approche socioéconomique du courant de l’économie de communion. Ce courant est né au Brésil en 1991 à l’initiative de Chiara Lubich, plus connue comme fondatrice du Mouvement des Focolari. Devant la violence des écarts sociaux, à cette époque, au sein de la métropole de San Paolo, elle a qualifié cette situation comme un « manque de l’amour du frère ». Ayant l’intuition que cet amour du frère devait d’abord s’incarner au sein des entreprises comme créateurs de richesses et comme responsables, dès la création de ces richesses, de leur juste répartition entre toutes les parties prenantes. Il est apparu très vite que cette amour du frère au sein des actes économiques concerne tous les agents économiques, y compris les consommateurs-épargnants comme décideurs en dernier ressort. Sans oublier l’enjeu d’un développement durable qui permette, à la fois, le respect de l’environnement et la préférence pour les personnes dans le besoin. Tout est lié. L’économie de communion est une économie inclusive et durable qui ne remet pas en cause le libre marché et la concurrence comme facteur de définition du prix des échanges, mais qui interpelle nos comportements d’agents économiques comme porteurs de justice et de paix. La puissance publique a un rôle majeur d’accompagnement et de facilitateur pour l’application, par les agents économiques, d’un juste prix aux échanges, du point de vue d’une vie digne pour tous et du respect de la nature. Ce juste prix doit rester libre.
Retrouver l’intégralité de l’article ici